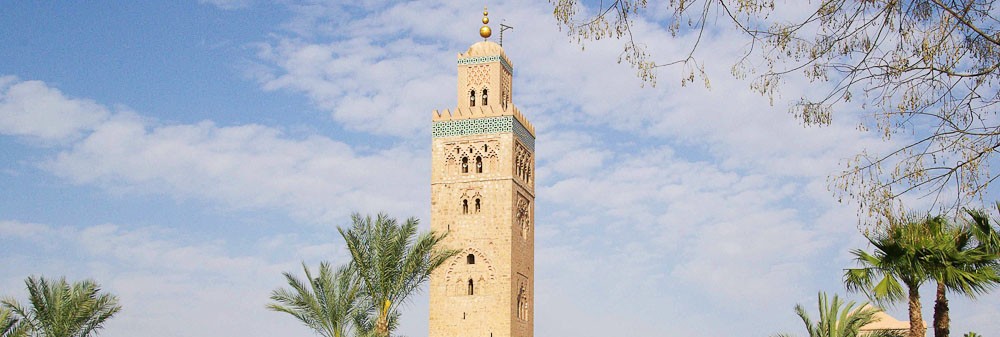La question de l’observation du croissant ?
La question de l’observation du croissant sonne comme une invitation à une réflexion élargie sur la place de l’astronomie, des sciences en général et de leurs méthodes dans le monde musulman contemporain.
Le fait d’observer à l’œil nu relève d’une technique d’observation rudimentaire en astronomie puisqu’un œil est une chambre noire « Al bayt almodlim ou camera obscura d‘Ibn alhaîtham« . Un trou dans cette chambre noir permet de projeter une image en l’occurrence l’image du croissant lunaire sur la rétine de l’œil. Cela fait partie des connaissances préalable à l’école secondaire.
Durant cet article, on va pas discuter des positions de la lune, mais plutôt des critéres de validation d’une observation à l’oeil nu. Autrement dit, Si quelqu’un nous dit qu’il a vu un croissant est ce que c’est possible ou non ?
Les occasions et les fêtes religieuses chez le musulmans sont datées par le calendrier lunaire. Le début de chaque mois est défini par la première observation du croissant. Cette démarche, qui fait reposer le calendrier sur des témoignages visuels, conduit souvent à des situations en contradiction avec les données astronomiques.
Fondé sur l’observation visuelle du croissant lunaire, et reposant donc en pratique sur des critères peu rigoureux, des erreurs peuvent se faire jour lors de la détermination du début de chaque mois. Du fait de l’absence de test ou d’expertise des témoignages, voire à cause des illusions d’optique favorisées par les effets atmosphériques, il n’est pas rare d’aboutir ainsi à des situations où des millions de personnes dans deux pays voisins, ou dans un même pays, observent des fêtes ou débutent les mois à des dates différentes.
Il s’ensuit un malaise de la société musulmane, particulièrement perceptible lors de la détermination du commencement du mois de ramadan.
Dans le calendrier islamique, le Ramadan est le neuvième mois de l’année. Il débute au lendemain de l’apparition du nouveau croissant juste après une conjonction* , et se termine après une nouvelle observation du croissant naissant qui, elle, signale la rupture du jeûne l’aid el-fitr.
L’observation à l’oeil nu du croissant lunaire se fonde principalement sur un célèbre hadith du Prophète Mohammed salla allahou 3allayhi wa sallam :
أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُنَادِي ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ.
« Jeûnez après l’observation [du croissant] et célébrez la fin [du ramadan] après l’observation ; si le temps est couvert, complétez 30 jours de Châbane ».
Le Prophète Muhammad (que la prière et la paix d’Allah soient sur lui) ne dit cependant rien des critères qui permettraient de valider ces observations.
Les critéres de l’acceptation d’une observation du croissant ont été abordés et définis en premier lieu par les quatres écoles de jurisprudence sunnites islamique » Malékite, hanafite, shafiite et hanbalite« .
L’observation est envisagée comme un « témoignage » chahada , dont la véracité ne dépendrait que de la piété ou de l’appartenance sociologique de l’observateur. Ainsi l’observation du croissant, insérée dans cette démarche religieuse, n’est assimilée que secondairement à une observation astronomique. L’expertise des illusions d’optique et autres erreurs d’observation sont rarement envisagées.
Reste que ce rejet radical de l’expertise astronomique n’a jamais été unanime dans la tradition musulmane. On peut citer l’exemple de Assoubki, un shafiite, qui déclarait nulle toute observation considérée comme impossible par l’astronomie.
Et c’est bien dans cet esprit que s’est développée l’astronomie musulmane. Son souci constant ayant toujours été de placer au service de la foi les techniques et les connaissances acquises au prix de patientes accumulations d’études et d’observations.
Ainsi, on constate un engouement marqué des astronomes médiévaux de l’Islam pour la résolution de la question de l’observation du croissant lunaire.
Le mathématicien Al-Khwarizmi stipule que le croissant peut être vu si la Lune est séparée du Soleil d’un angle de 12° le long de l’équateur céleste, au moment de son coucher.
Un critère plus précis est celui d’Ibn Tariq : l’observation du nouveau croissant est possible si une des deux conditions suivantes est remplie toujours au moment du coucher du Soleil :
soit le délai entre le coucher du Soleil et celui de la Lune dépasse 48 mn, et l’angle entre les deux astres est supérieur à 11,25°,
soit le délai est supérieur à 40 mn et l’angle apparent dépasse 15°.
Un autre critère également important, utilisé par Tabari, stipule que le croissant pourra être vu si, au moment du coucher de la Lune, le soleil dépasse une certaine hauteur au-dessous de l’horizon local. Al-Battani introduit dans ses calculs l’azimut et la distance Terre-Lune.
Ibn Yunus a évoqué pour la première fois l’importance des conditions météorologiques et des aptitudes visuelles de l’observateur. Il considère l’épaisseur du croissant ainsi que la vitesse orbitale de la Lune.
Un astronome de l’observatoire de l’université d’Oxford, James Fotheringham a proposé, dès 1910, un nouvel algorithme simple de prédiction. Celui-ci se révèle en fait assez similaire aux critères posés par les astronomes de l’Islam : il est lui aussi fondé sur des considérations purement géométriques des positions relatives du Soleil, du croissant et de l’observateur.
Mohammed Ilyas, un physicien de l’université des Sciences de Malaisie, a amélioré le critère de Fotheringham. Pour cela, il a considéré tout le globe terrestre et, prenant un par un quelque 300 points au total, il a pu faire ressortir une ligne de séparation. A l’ouest de cette ligne le croissant est visible le soir du nouveau mois, alors qu’à l’est il ne peut être vu que le soir.
Franz Bruin, un chercheur de l’observatoire de l’université américaine de Beyrouth, a tenté de dépasser les critères purement astronomiques de ses prédécesseurs en y ajoutant des considérations sur le contraste de brillance entre le croissant lunaire et le ciel, et sur la limite de détection de l’oeil humain.
Bradley Schaefer, un astrophysicien de la NASA à Yale a proposé d’améliorer l’algorithme de Bruin en ajoutant à la prise en compte de tous les effets de mécanique céleste et de physiologie ceux de la météorologie locale : absorption et extinction des rayons lumineux en provenance de la Lune, température au sol, humidité du site d’observation, effets saisonniers, etc.
Restait à tester les différents modèles en les confrontant aux observations. Cinq campagnes d’observation ont été menées à travers le monde. Les résultats obtenus se sont révélés assez impressionnants : pas moins de 2 500 volontaires ont participé à l’aventure.
L’analyse des observations a ainsi révélé, d’une part, 15 % d’erreurs « positives » . C’est-à-dire 15 % de cas où le croissant n’était pas visible, mais où des personnes affirmaient l’avoir repéré. Et, d’autre part, 2 % d’erreurs « négatives ». Autrement dit, de cas où le croissant est parfaitement observable, mais où des personnes reconnaissaient ne pas l’avoir vu.
Ces résultats suggèrent déjà l’importance du facteur humain. Il apparaît dès lors intéressant de considérer comment de telles discordances peuvent apparaître concrètement et s’analyser dans un pays musulman.
C’est dans cet esprit, que le magazine la recherche s’est livrés à une étude comparative des dates religieuses telles qu’elles ont été décrétées par les autorités officielles en Algérie, entre 1963 et 1994, avec les calculs astronomiques.
Pour cela, ils ont considéré les dates du début du mois du jeûne 1er ramadan, de la fête de la rupture du jeûne 1er shawal et de la fête du Sacrifice 10 dhul-hijja.
Les données historiques ont été rassemblées à partir des archives de la presse algérienne. Elles ont ensuite été confrontées aux éphémérides astronomiques relatives à la ville d’Alger. Ainsi, pour chaque date décrétée sur la base d’une « observation » du croissant, reconnue valide par les autorités religieuses, il a été possible de déterminer la date et l’heure de la conjonction correspondante, le délai entre les couchers du Soleil et de la Lune, ainsi que l’angle qui sépare les deux astres au moment de l’observation.
Étude du magazine la recherche :
Premier constat, l’existence d’un nombre élevé de cas où le mois a été décrété par les autorités, alors que la conjonction n’avait même pas encore eu lieu et/ou que la Lune s’était couchée avant le Soleil l’observation du croissant étant alors strictement impossible.
Sur quatre-vingt-dix-huit dates, quatorze cas de ce genre se sont présentés, soit un taux de 14,3 % ! Dans environ la moitié des 98 cas, une des limites absolument établies a été violée. Et si l’on considère les critères de prédiction, dans au moins trois cas sur quatre, les instances officielles étaient en contradiction avec les prédictions astronomiques.
De 1963 à 1972 : Une vingtaine d’erreurs sur trente-deux dates au total (10/16). « Correspond à l’indépendance et donc absences des spécialistes ».
De 1973 à 1988 : Une dizaine d’erreurs sur quarante-huit dates (10/48). » Présence des spécialistes « .
De 1989 à 1994 : Une dizaine sur dix-huit cas (10/18). « Retour au témoignage visuel « .
Un malaise profond !!
D’un côté, nous avons une question à laquelle il est possible de fournir aujourd’hui une réponse rigoureuse. De l’autre, une réticence d’un corps social à adopter cette solution.
Source Magazine La recherche.
ET ALLAH SAIT TOUT