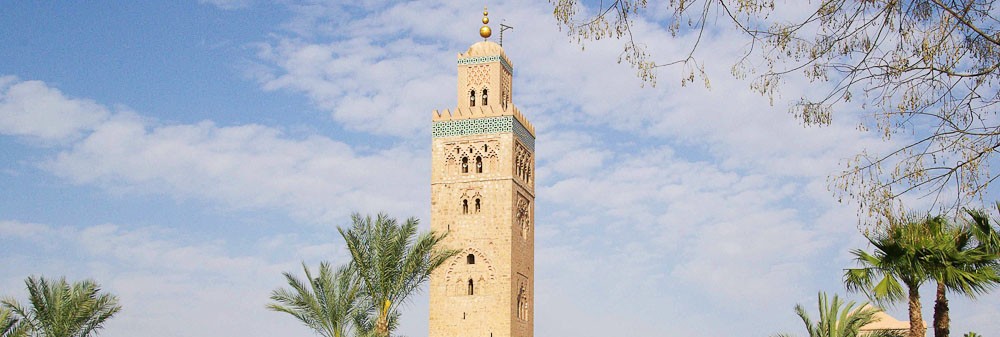LES ARMES DANS LE SOUS » 1845 – 1900 »
D’après les ressources
« Mission de reconnaissance au Maroc »
« Archives berbères »
et « Enseignements et tactiques des deux guerre franco-marocaine (1844) et hispano-marocaine (1859-1860) »
FUSILS :
Les fusils les plus répandus, arme simple et très usagée, entre les mains du premier venu, objet de parade, sont les «Bou Chfers », fusils à pierre et « Bou Haba », fusil à capsule. Les systèmes sont le travail de maalems spéciaux dont les plus connus sont : le maalem Mohammed Ould Dounhim d’Il Aouina et Bihi ben Hammou deTiznit. Un bon fusil BouHaba vaut en moyenne 100 ryal zabil ou 66 ryal hassani.
Ryal sabil que les juifs appelaient zabil « vient d’isabelle II régne d’Espagne de 1830 à 1864»,
LES CANONS :
Il y a deux sortes de canons portant les noms de «abouri» et de « tarouhalt ». Le canon dit «abouri» présente à la bouche un renflement ovalisé de 2 centimètres de hauteur. Le tarouhalt, le cylindre s’évase à la bouche en prenant extérieurement la forme d’un prisme octogonal. Ces canons sont fabriqués en général par des Boudrara, montagnards du Petit-Atlas. On signale comme les plus habiles les maalems : Tidlides Idaou Semlal, Znadet Larbi Faradji.
PISTOLETS :
Le pistolet est l’arme des marchands et des chefs de caravane.On en fabrique des modèles assez grossiers « Khemassi ».
ARMES A TIR RAPIDE « ABJIBS » :
Il paraît intéressant de citer pour mémoire les divers modèles d’armes a tir rapide, répandus dans le Sous Occidental.
Ce sont :
Tanjaoui, Menebbi, Settachia (16 coups), Tsaia (9 coups), Rbaia (4 coups).
LA POUDRE :
Il est facile aux indigènes de se procurer de la poudre fabriquée tant bien que mal dans le pays. Les matières premières et les méthodes employées étant les mêmes, les différences notables de qualité constatées entre les poudres de diverses provenances, sont dues à la plus ou moins grande habileté du fabricant. Certains maalems à Tiznit, â Mira (Idaou Baquil) sont particulièrement réputés pour la force et la finesse de leur poudre, c’est à eux qu’on s’adresse pour la confection des cartouches, la poudre de qualité secondaire suffisent le plus souvent pour le chargement des fusil s à pierre ou à capsule.
Anecdote :
« Les fabricants de poudre de Tiourgan ont compté de nombreuses victimes dans une explosion de poudre qui a eu lieu quatre ou cinq ans au Souk tlBareud du Moussera du Ttseroualt. »
AMORCES ET CAPSULES :
La fabrication des amorces a une grande importance au point de vue du ravitaillement en munitions, puisqu’elle permet l’utilisation des vieux étuis de cartouches, mais c’est une opération délicate que n’entreprennent que des maalems fort peu nombreux, à Tiznit et chez les Ahel Mader. D’où le prix relativement elevé des amorces. La matière détonante, empruntée aux allumettes-bougies, est délayée dans du pétrole. Le couvre-amorce est fait d’une mince feuille de plomb.
CARTOUCHES :
Un maalem fort adroit des Ahel Mader, Mohammed ou Taliar Resmouki, réussit a façonner des étuis avec du cuivre provenant de vieux plateaux. Il est intéressant de noter qu’il jurait refusé comme métal insuffisamment pur pour son industrie des douilles de 63 ou de 75 qui lui ont été apportées de Marrakech. Habile fabricant d’amorces, il confectionne des cartouches de divers calibres qu’il vend au prix de1 peseta zabil la cartouche.
SABRES :
Les sabres sont rares et sont toujours apportés d’autres régions, mais on les garnit souvent d’ornementations dans le goftt local.
Commandant Mordacq
Les deux dernières guerres qui mirent en présence les Européens et les Marocains, celle de 1844 (France et Maroc) et de 1859-1860 (Espagne et Maroc) nous ont semblé pouvoir fournir les enseignements les plus utiles.
On ne saurait oublier, d’ailleurs, qu’en 1844 le maréchal Bugeaud n’a pour ainsi dire pas pénétré au Maroc, qu’il n’a eu affaire qu’à la cavalerie marocaine envoyée en toute hâte à sa rencontre, et qu’ainsi que lui-même l’écrivait quelques jours avant la bataille d’Isly, il lui eût fallu « des moyens tout autres pour pénétrer au Maroc».
On peut se demander pourquoi le maréchal Bugeaud ne poursuivit pas Muley-Mohammed l’épée dans les reins. La raison en est bien simple : l’état d’épuisement de ses troupes ne le lui aurait pas permis. Il entrait près de 200 malades par jour à l’ambulance.
La guerre de 1844 fut, en effet, conduite sur un terrain complètement découvert et donna lieu à un combat où les Marocains n’opposèrent presque que de la cavalerie ; tandis que celle de 1859-1860 se poursuivit à travers un pays des plus difficiles, particulièrement couvert et accidenté, et où naturellement les Marocains n’engagèrent presque uniquement que de l’infanterie.
La guerre hispano-marocaine de 1859-1860 montrera que du fait que les Marocains, à la bataille d’Isly, n’ont pour ainsi dire pas engagé d’infanterie, il n’en faudrait pas conclure cependant qu’ils ne peuvent en mettre en ligne. Dans tous les combats aux environs de Ceuta, et pendant la marche sur Tétouan, nous verrons les espagnols constamment attaqués par une infanterie nombreuse et des plus audacieuses qui, très souvent même, les tint en échec.
Les difficultés que rencontra le général espagnol O’Donnel, qui dirigea cette campagne espagnole, furent énormes, surtout au point de vue des transports et du climat, et — il faut le reconnaître aussi — au point de vue des adversaires.
Pendant cette guerre hispano-marocaine, les fantassins marocains, formés généralement en groupes de 400 à 500 hommes, se déployaient sur 3 rangs, un peu éloignés l’un de l’autre. Le premier rang tiraillait à l’abri des arbres et des rochers; le second, sans armes, ramassait et emportait les morts ou les blessés, puis prenait leurs armes et les remplaçait. Le troisième rang formait la réserve. Combattant jusqu’au bout, fantassins et cavaliers marocains ne se rendaient jamais (les Espagnols, dans tout le cours de la campagne, firent à peine une dizaine de prisonniers).
L’effectif de l’armée ordinaire, entretenue par l’empereur Abd-Er-Rahman, était de 25.000 hommes, sur lesquels on comptait 12.000 réguliers ou soldats d’infanterie; le reste comprenait 16.000 hommes de la garde noire, 4.500 cavaliers maures et 2.500 hommes d’artillerie.
Conclusion :
Après la bataille d’Isly, Sidi-Mohammed, jugeant avec raison que la défaite des troupes marocaines était due surtout à leur manque d’organisation, créa des troupes régulières dites Nichans. Et moi, je rajoute le manque d’instruction généralisé pour un développement humain et matériel.
Wa choukrane !!