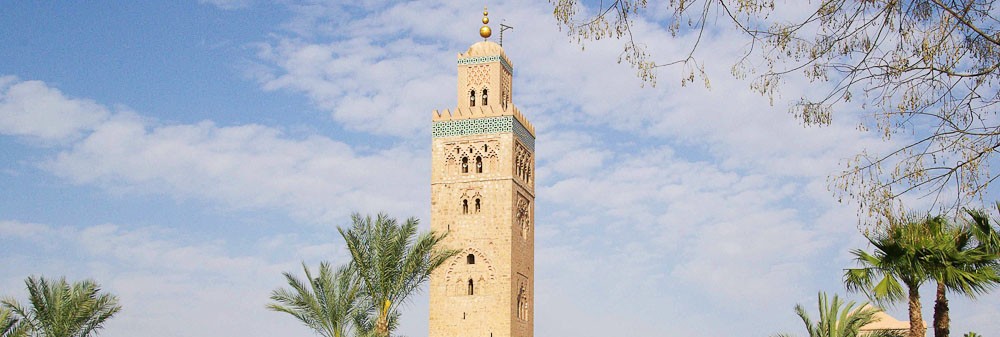Gotthelf Bergsträsser dit :
« Aucun peuple n’a précédé les Occidentaux dans ce domaine (la linguistique) sauf deux peuples, à savoir les Indiens et les Arabes ».
La linguistique moderne a souvent été considérée comme une discipline «scientifique», une discipline qui se concentre sur « l’enquête systémique de la langue « . La linguistique se décompose en plusieurs secteurs tels que la phonétique, la phonologie, la morphologie, syntaxe, pragmatique, le discours et la sémantique.
L’étude de la phonétique chez les Arabes remonte, conjointement avec les autres branches de la linguistique au premier siècle de l’Hégire. Le Coran était la base de ces études linguistique de la langue arabe. La raison principale pour son développement a été le désire de préserver le texte du Coran de la corruption. Cela s’est manifesté à, ce moment principalement dans la science de tajwid (recitation correcte du Coran).
L’énorme volume de livres consacrés à l’interprétation et l’explication du saint Coran « tafaasyr » sont des études directement liée à la signification, linguistiquement qualifié de sémantique.
L’un des savants qui ne sont pas normalement associés à la sémantique arabe est IBN JINNI. En fait, il est davantage associé à l’étude des sons en arabe. Ce sous-domaine de l’étude des sons d’une langue est linguistiquement qualifié de phonétique. Toutefois, IBN JINNI pourrait être associé à la sémantique.
IBN JINNI (992 A. J.) fut le premier à consacrer tout un travail à la phonétique, « Sirr sina’at al I’rab » et cela demeurera l’un des ouvrages les plus connu en arabe sur le sujet.
IBN JINNI dit dans son livre (I / 59) :
« Je connais aucun de nos compagnons (il signifie probablement les linguistes appartenant à l’école de Basrah) qui a réalisé dans ce domaine autant que ce que j’ai réalisé. J’en ai discuté pleinement des particularités de ce domaine ».
Et il avait raison, parce que même après lui, aucun savant arabe ne donnait à la phonétique autant d’attention que lui.
Avant IBN JINNI, les études concernant le coran se limité à la grammaire. Sibawayh, le père de la grammaire arabe, décrit les sons arabes avec Idgham qui est considéré comme faisant partie de l’assimilation.
Sibawayh dit:
« J’ai décrit les sons associées aux lettres de l’alphabet afin que vous sachiez à quel moment le Idgham est appropriée ou admissible et à quel moment il est inapproprié ou inadmissible ».
Par exemple, il est intéressant de savoir que le préfixe « ad » en latin a une certaine similitude avec le préfixe arabe « al ». Le (d) du préfixe (ad) montre une tendance à assimiler « Idgham » une consonne suivante en fonction de la position ou du temps.
Un aperçu du son :
L’arabe a vingt-huit consonnes et six voyelles dont trois sont courts et trois sont longues. Le nombre total des sons arabes est de trente-quatre. Alors qu’il y a seulement trente-deux signes dans le système d’écriture arabe.
IBN JINNI a décrit les sons arabes de deux façons :
Al Makhradj « Points d’articulation » et Al Shifah « Mode d’articulation », une manière d’étude similaire à celle des linguistes modernes.
En décrivant des sons en fonction de leur point d’articulation, il commence par les sons prononcé dans la gorge et finit par ceux prononcée sur les lèvres.
Venons-en maintenant à la question de la méthode utilisée pour découvrir où un son est articulé. La réponse se trouve dans une déclaration d’Ibn d’al-jazari : « La méthode de détermination du point d’articulation est de produire le son après « Hamzat al Wasl ma3a sukoun aw Tashdid ». Il s’agit de la façon la plus claire de distinguer et d’apprécier les caractéristiques d’un son ».
Un aperçu des voyelles :
Bien que les linguistes arabes différencie entre les longues voyelles et les courtes voyelles en considérant les longues comme hurouf (lettres) et les courtes comme Harakate (mouvements). Les deux sont les mêmes, sauf dans la durée.
IBN JINNI dit :
« Sachez que les harakates (court voyelles) sont des parties de Hurouf al-madd wal-lin (longues voyelles). »
Et Il poursuit : «Vous ne savez pas que la voyelle courte peut devenir une longue voyelle avec al ishba’a ».
En ce qui concerne la voyelle en général, «il semble évident que IBN JINNI (et d’autres linguistes arabes) sont conscients de la distinction entre la phonétique et la phonologie.
Un aperçu des consonnes :
Abu ‘3Amr et certains de ses disciples ont comptés plus de vingt-cinq cas où, elles permettre trois groupes de consonnes de se produire, en violation des théories des grammairiens et des savants de tajwid.
Voici quelques exemples:
Ibrahim Anis dit:
« Je n’ai pas trouvé jim suivie par kaf en arabe excepté en un ou deux mots étranges, comme Jakara (tenter de vendre difficilement) « .
IBN JINNI dit sur l’histoire de petits changements dans les sons :
« Les Arabes baisse « al hamzah » en quatre mots d’usage commun. Ce sont : khabiyah (grand navire) de khabaa’ ( peau), bariyyah (l’humanité) à partir de baraa’ (créer), nabi (prophète) de nabaa’ (nouvelle), et Dhurriyah (enfants) de Dharaa’ (donner).
Un aperçu de la fonction emphatique :
IBN JINNI cite : wallahu (et Dieu), wallahu (il l’a nommé).
Les deux unités semblent être les mêmes en forme, même si elles ne sont pas, puisque chacune d’elles en fait contient deux mots distincts, qui sont complètement différents dans les deux cas.
La première se compose de WA-(et) et-ALLAH (Dieu).
La seconde consiste à WALLA-(il a nommé) et HU (lui).
Un clein d’oeil à la reconnaissance vocal :
Les deux mots différer des deux sons et donc le sens est également différent.
Au cours de plusieurs recherches sur les livres écrits par des linguistes arabes dans le domaine de linguistique, on a constaté qu’ IBN JINNI a utilisé des méthodes uniques lorsqu’il s’agit de problèmes de sons produits par un mot arabe et le sens transmis lorsque ce mot a été produit par voie orale.
Les œuvres d’IBN JINNI sont précurseurs dans le sens ou il montre le lien entre le son et la signification. elles ont ouverts des portes qui n’avait jamais été précédemment ouvertes par d’autres chercheurs avant lui ».
IBN JINNI n’a pas reçu toute l’attention qu’il mérite en tant que l’un des érudits dans ce domaine. Ceci peut être vu par le manque d’informations sur ses travaux.
Dommage, qu’on a pas été instruit par ce genre de figures de la langue arabe. Ces contributions aurait pu donner un autre souffle à l’apprentissage de la langue arabe au lycées.
Ra7imahou Allah.